Depuis le 23 juillet 2025, une nouvelle signalétique relative à l’interdiction de fumer est en vigueur.
Les anciens modèles d’affichage ne sont valides que jusqu’en janvier prochain⏰.
👉Pour rappel, l’employeur doit afficher un certain nombre d’informations obligatoires dans l’entreprise. L’interdiction de fumer ou encore de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif en fait partie !
📋Pensez à mettre régulièrement à jour votre affichage obligatoire !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Maître Mélina ALAMELAMA, qui a rejoint notre équipe contentieuse en tant qu’avocat en droit commercial et procédures collectives.
Mélina ALAMELAMA intervient à tous les stades précontentieux et contentieux dans les intérêts des entreprises et de leurs dirigeants, y compris en période de restructuration.
Son expertise et son expérience préalable en matière de Conseil vient consolider notre accompagnement des clients dans la gestion des dossiers ou conflits sensibles, notamment à forts enjeux financiers.
Bienvenue à elle !

Le cabinet QUINTES AVOCATS, pour son département contentieux, recherche un(e) AVOCAT(E) COLLABORATEUR(TRICE) LIBERAL(E) en droit social.
Expérience : 2 – 5 ans
Basé à Lyon et à Villefranche sur Saône, le Cabinet QUINTES AVOCATS intervient en droit social (conseil et contentieux) et contentieux des affaires.
Il se compose d’une équipe jeune et dynamique, intervenant aux côtés des entreprises et dirigeants. L’équipe est organisée en deux départements : l’un dédié au Conseil social aux entreprises, l’autre dédié au Contentieux.
Le cabinet porte une attention particulière à la formation (à destination tant de ses membres que de ses clients), au travail en équipe, et à l’expertise de ses membres dans leur domaine respectif.
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), motivé(e) et impliqué(e).
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques et procédurales, de qualités relationnelles et d’un goût pour le travail collectif / en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans un cabinet en développement, attaché à proposer une offre proactive à ses clients.
Vous disposez d’une expérience allant de 2 à 5 ans en qualité d’avocat en droit social (à dominante contentieux).
Vous serez amené(e) à traiter, en binôme, les contentieux employeur en droit social et droit de la sécurité sociale.
Possibilité de s’investir dans les projets internes du cabinet (formation notamment).
Déplacements à prévoir
Rétrocession fixe + variable à déterminer selon profil
Ouverts au télétravail
Evènements cabinet pluriannuels + formations externes et internes
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivant :
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.
Le cabinet QUINTES AVOCATS, dans le cadre du développement de son département contentieux des affaires, ouvre un poste à destination d’un(e) AVOCAT(E) COLLABORATEUR(TRICE) LIBERAL(E) en contentieux commercial et procédure collective.
Expérience : 3 – 5 ans
Qui sommes-nous ?
Basé à Lyon et à Villefranche sur Saône, le Cabinet QUINTES AVOCATS, intervient en contentieux des affaires et droit social.
Il se compose actuellement d’une équipe de 7 personnes (avocats et assistants), et de deux départements : l’un dédié au Conseil en droit social, l’autre dédié au Contentieux.
Votre profil
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), motivé(e) et impliqué(e).
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques et procédurales, de qualités relationnelles et d’un goût pour le travail en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans un cabinet dynamique et en développement.
Vous disposez d’une expérience allant de 3 à 5 ans en qualité d’avocat en droit commercial.
Vous serez amené(e) à traiter, aux côtés de Maître FLICOTEAUX, les contentieux en droit commercial / procédure collective.
Informations complémentaires
Déplacements à prévoir
Rétrocession fixe + variable à déterminer selon profil
Ouverts au télétravail
Evènements et formation cabinet pluriannuels
Contact
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivant :
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.
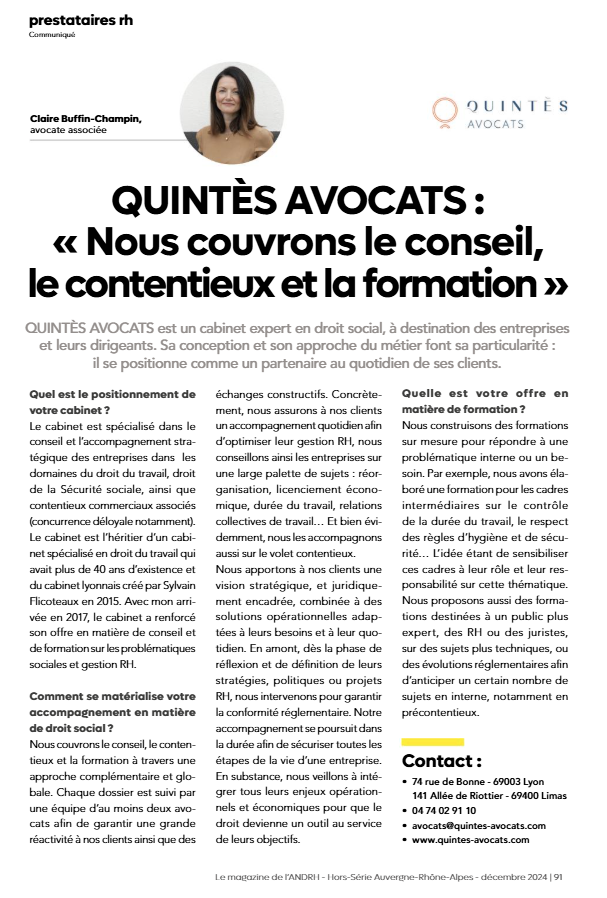
Le cabinet QUINTES AVOCATS, dans le cadre du développement de son département contentieux, recherche un(e) AVOCAT(E) COLLABORATEUR(TRICE) LIBERAL(E) en droit social.
Expérience : 3 – 5 ans
Qui sommes-nous ?
Basé à Lyon et à Villefranche sur Saône, le Cabinet QUINTES AVOCATS, intervient en droit social et contentieux des affaires.
Il se compose actuellement d’une équipe de 7 personnes (avocats et assistants), et de deux départements : l’un dédié au Conseil aux entreprises, l’autre dédié au Contentieux.
Votre profil
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), motivé(e) et impliqué(e).
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques et procédurales, de qualités relationnelles et d’un goût pour le travail en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans un cabinet dynamique et en développement.
Vous disposez d’une expérience allant de 3 à 5 ans en qualité d’avocat en droit social (à dominante contentieux).
Vous serez amené(e) à traiter, aux côtés de Maître FLICOTEAUX, les contentieux employeur en droit social et droit de la sécurité sociale.
Informations complémentaires
Déplacements à prévoir
Rétrocession fixe + variable à déterminer selon profil
Ouverts au télétravail
Evènements cabinet pluriannuels
Contact
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivant :
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.
💸Pour rappel, les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumises à l’obligation de participation, doivent, si leur bénéfice net fiscal est au moins égal à 1% du chiffre d’affaires réalisé pendant 3 années consécutives, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour leur exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025.
Ce dispositif peut prendre les formes suivantes :
👉 Un accord d’intéressement ou de participation ;
👉 Une prime de partage de la valeur (PPV) ;
👉Un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).
❌Les entreprises individuelles et les sociétés anonymes à participation ouvrière ne sont pas concernées par cette obligation.
❌Les entreprises qui ont déjà mis en place l’un de ces dispositifs au titre de l’exercice suivant la période des 3 ans susvisées ne sont pas concernées non plus.
hashtagdroitsocial hashtagconseil hashtagavocat hashtagentreprises hashtagpartagedelavaleur
Ceux qui sont victimes d’actes de concurrence déloyale, notamment de la part de leurs salariés ou anciens salariés, le savent : les soupçons sont aisés, parfois rapides, mais la preuve de la réalité de tels agissements peut s’avérer beaucoup plus complexe, voire impossible à obtenir. Or, en matière d’action judiciaire, dont l’objet est d’obtenir réparation du préjudice subi, tout est question de preuve.
👉 C’est pourquoi, il est crucial d’établir une véritable stratégie en collaboration avec votre Conseil habituel pour rechercher (y compris chez un tiers), conserver et exploiter les éléments de preuve permettant de construire un dossier sérieux, dont les pièces seront conformes aux exigences légales et jurisprudentielles.
En la matière, l’article 145 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de solliciter une mesure d’instruction pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Cette disposition permet de solliciter du juge qu’il désigne un Commissaire de justice qui aura pour mission de saisir ou de prendre copie d’éléments précisément désignés, dans un lieu spécifiquement visé, ou encore de faire toutes constatations utiles.
🔇 Cette mesure peut être ordonnée de manière non contradictoire ce qui permet un effet de surprise afin d’éviter des manœuvres de destruction ou de dissimulation de preuve.
📝Il est nécessaire, avant de saisir le Président du Tribunal, d’anticiper précisément les éléments à récupérer, ainsi que les lieux visités, et de s’assurer que les conditions légales en sont réunies, notamment le respect des droits et principes fondamentaux, ainsi que la loyauté dans la recherche de la preuve. La rédaction de la requête et du projet d’ordonnance sera l’un des facteurs déterminant du succès de la mission.
🔎Un travail en étroite collaboration avec le Commissaire de Justice qui sera chargé de l’exécution de l’ordonnance est nécessaire pour garantir l’efficacité de la mesure.
Les clés de la réussite en la matière : anticipation et construction rigoureuse du dossier pour une meilleure efficacité !
hashtagdroitcommercial hashtagconseil hashtagentreprises hashtagavocat
